Version française / Formations scientifiques
- Recherche - CLM,
L’analyse de la posture du chercheur : approche anthropologique et sociologique du regard situant
Publié le 9 juillet 2025
–
Mis à jour le 15 juillet 2025
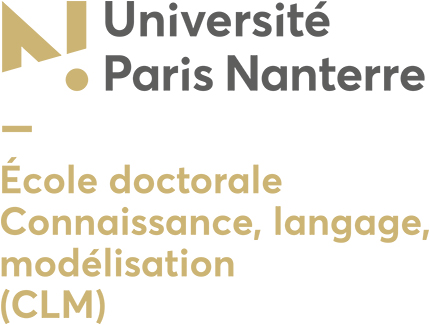
Date(s)
du 25 mars 2026 au 26 mars 2026
Date : 25 et 26 mars 2026
Durée : 12h
Horaires : 9h30 à 16h30
Format : présentiel
Lieu : salle A305, bâtiment René Rémond
Nombre de participants maximum : 12
Public visé : doctorant.e.s de l’ED 139
Type de formation : séminaires transversaux des ED
Pré-requis pour la formation (matériel, installation de logiciel, etc.)
Nom des intervenant.e.s :
Peut-on suivre uniquement certains modules de cette formation ? OUI
Mode d’inscription : ADUM
CONTEXTE DE LA FORMATION
Dans le cadre de maintes situations de recherche en sciences humaines et sociales, le chercheur qui observe et analyse pose non seulement un regard sur l’objet de recherche mais de surcroît interagit avec le phénomène étudié.
Aussi, le regard est « situé », dans la mesure où un.e chercheur.e, selon le contexte sociologique et culturel dans lequel il a vécu et vit, avec sa propre matrice de références et son épistémè, construit son observation et développe son analyse.
Mais le regard situe aussi bien le sujet qui regarde que l’objet qui est regardé. Par sa présence, l’observateur interfère avec le phénomène observé. Cette interférence émane d’une interaction, dans le cadre d’enquête ou d’observation de « terrain » par exemple, puisque la présence physique de la personne effectuant des recherches (sa présentation, son identification, son attitude, sa relation…) modifie le phénomène observé par sa simple présence. Aussi, pour un chercheur impliqué sur son « terrain de recherche », cette immersion est aussi, de fait, une action. Cette interférence, ou « intersubjectivité », peut également s’observer en dehors de toute présence physique, ne serait-ce que dans la façon de structurer un questionnement préalable ou la visibilité et la compréhension de données fournies dans le cadre de recherches sur des données préalablement collectées. Ainsi, l’objet observé est transformé par la présence de l’observateur et par son regard ; le « regard » n’est pas seulement « situé » mais devient situant ».
OBJECTIFS
OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
PROGRAMME
BIBLIOGRAPHIE :
SÉRAPHIN Gilles, « Le « regard situant » : proposition de méthode d’analyse du regard en situation de recherche », Questions Vives. Recherche en éducation, n° 38, 2022. https://journals.openedition.org/questionsvives/7557
SÉRAPHIN Gilles, MESSU Michel, Le regard situant - Volume 1, à paraître fin 2025.
Durée : 12h
Horaires : 9h30 à 16h30
Format : présentiel
Lieu : salle A305, bâtiment René Rémond
Nombre de participants maximum : 12
Public visé : doctorant.e.s de l’ED 139
Type de formation : séminaires transversaux des ED
Pré-requis pour la formation (matériel, installation de logiciel, etc.)
Nom des intervenant.e.s :
Peut-on suivre uniquement certains modules de cette formation ? OUI
Mode d’inscription : ADUM
CONTEXTE DE LA FORMATION
Dans le cadre de maintes situations de recherche en sciences humaines et sociales, le chercheur qui observe et analyse pose non seulement un regard sur l’objet de recherche mais de surcroît interagit avec le phénomène étudié.
Aussi, le regard est « situé », dans la mesure où un.e chercheur.e, selon le contexte sociologique et culturel dans lequel il a vécu et vit, avec sa propre matrice de références et son épistémè, construit son observation et développe son analyse.
Mais le regard situe aussi bien le sujet qui regarde que l’objet qui est regardé. Par sa présence, l’observateur interfère avec le phénomène observé. Cette interférence émane d’une interaction, dans le cadre d’enquête ou d’observation de « terrain » par exemple, puisque la présence physique de la personne effectuant des recherches (sa présentation, son identification, son attitude, sa relation…) modifie le phénomène observé par sa simple présence. Aussi, pour un chercheur impliqué sur son « terrain de recherche », cette immersion est aussi, de fait, une action. Cette interférence, ou « intersubjectivité », peut également s’observer en dehors de toute présence physique, ne serait-ce que dans la façon de structurer un questionnement préalable ou la visibilité et la compréhension de données fournies dans le cadre de recherches sur des données préalablement collectées. Ainsi, l’objet observé est transformé par la présence de l’observateur et par son regard ; le « regard » n’est pas seulement « situé » mais devient situant ».
OBJECTIFS
- Analyser et exposer en quoi son « regard » est situé et « situant ».
- Développer dans ce cadre les précautions éthiques à l’égard de toute personne qui participe à une recherche (chercheur.e, collaboratreur.trice de recherche, participant.e…).
OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Présentation du cadre théorique du « regard situant ».
- Étude de situation concrète exposée par l’enseignant.e.
- Échanges sur des situations rencontrées par les doctorant.es.
PROGRAMME
- Mercredi 25 mars 2026, 9h30-12h30 : « Le regard situant : approche sociologique et anthropologique théorique illustrée par des exemples pratiques » - Gilles Séraphin.
- Mercredi 25 mars 2026, 13h30-16h30 : « Le regard qui agit : perspectives décoloniales » - Laure Moguérou.
- Jeudi 26 mars 2026, 9h30-12h30 : « Le regard qui agit : apports des analyses de genre » - Chloé Riban.
- Jeudi 26 mars 2026, 13h30-16h30 : « Échanges et analyses sur les situations rencontrées par les doctorant.es dans leur travaux doctoraux » - Gilles Séraphin.
BIBLIOGRAPHIE :
SÉRAPHIN Gilles, « Le « regard situant » : proposition de méthode d’analyse du regard en situation de recherche », Questions Vives. Recherche en éducation, n° 38, 2022. https://journals.openedition.org/questionsvives/7557
SÉRAPHIN Gilles, MESSU Michel, Le regard situant - Volume 1, à paraître fin 2025.
Mis à jour le 15 juillet 2025
Inscription
Inscription via ADUM









